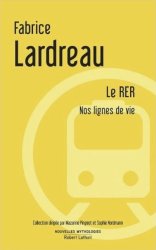Il y a de quoi écrire des romans sur le RER — Réseau Express Régional — qui sillonne l’Île-de-France telle une araignée fébrile sur sa toile. Fébrile, mais vieillissante, dépassée par les événements, et parfois en rade. Des romans il y en a. Je viens de lire un essai autobiographique de Fabrice Lardreau, intitulé Le RER, Nos lignes de vie, qui mêle éléments autobiographiques d’une bonne tranche de vie passée à proximité du RER B, avec des éléments historiques ou sociologiques concernant quelques millions de franciliens au quotidien. J’ai lu ce livre entre l’oreiller de mon lit et le fauteuil du RER sur lequel j’ai de plus en plus de peine à m’asseoir, sorte de nid crasseux ayant probablement supporté quelques dizaines de milliers de postérieurs divers et variés avec peut-être d’autres choses plus ou moins avouables — je préfère ne pas savoir, en fait. Si Fabrice Lardreau semble apprécier ces voyages quotidiens, certes dans une dimension bien plus optimiste et contemplatiste que la mienne, celle d’une saine promiscuité notamment, celle du rapport muet à l’autre, celle de l’autre dans une dimension extérieure sur laquelle on peut égrener le temps à imaginer tout l’intérieur, fantasmer sur un habillement, la marque ou l’état d’un téléphone portable, une lecture, une occupation — parfois je m’amuse à compter celles et ceux qui pianotent sur leurs smartphones dans mon voisinage immédiat et je compare avec celles et ceux qui bouquinent —, en ce qui me concerne, si je pouvais m’en passer, du RER, je le ferai volontiers. D’ailleurs j’ai déjà pas mal œuvré en ce sens en changeant de laboratoire pour passer de Paris intra-muros à la verte banlieue, à dix minutes de chez moi en vélo. Et oui, je préfère égoïstement dix minutes de vélo seul au grand air à soixante minutes de partage du même air vicié de boîte de conserve. Même si mes cours à l’université restent à Paris, au moins le reste du temps, je l’évite. Au maximum.
J’ai mis un peu de temps à me remémorer ce que le nom de l’auteur avait de familier. C’est qu’en fait je lis régulièrement ses articles dans la chouette revue de la FFCAM La Montagne et Alpinisme, dans lesquels il dépeint une personnalité, artiste, auteur, à travers le prisme de la montagne. Montagne qu’il semble aimer parcourir à pieds, ici ou là. Je ne m’attendais pas a trouver derrière cet auteur un parisien pur et dur, francilien, plutôt, banlieue sud, adepte depuis les origines du RER de ce réseau « express » à la fin des trente glorieuses.
Je n’ai pas dû y mettre les pieds suffisamment tôt, quant à moi, pour en apprécier la substantielle moelle. Je ne connais l’engin que depuis la fin des années 1990, épisodiquement avant, mais quotidiennement seulement entre 2005 et 2014, environ. Depuis, moins quotidiennement, au gré de mes cours à Paris et de mes réunions à l’université. Ou de mes sorties en montagne en car-couchettes au départ de Paris. N’ayant pas connu le début du tortillard, je n’ai pas le souvenir de la formidable avancée que sa mise en service a permis : rallier la lointaine banlieue au cœur de la capitale en moins d’une heure, le temps de lire quelques pages. Je n’ai subi que la lente détérioration du service — trente « honteuses » ? —, des trains d’un autre âge, des voitures à l’odeur et à la saleté éprouvante dont j’ai assez honte, curieusement, quand je dois y amener des amis étrangers ou même provinciaux. Je m’excuse auprès d’eux que mon pays, ma région n’ait pas mieux à leur proposer. Des horaires aléatoires ; quand j’ai cours à Paris à 9 h, il faut que je me lève à l’aube pour partir à 7 h et avoir ainsi suffisamment de marge au cas où. Car il faut prévoir le cas où pour garder la liberté d’arriver à l’heure. Des voitures bondées en particulier au retour, le soir. Debout au milieu d’autres corps meurtris par une journée de labeur à respirer difficilement un air souvent putride addition des différentes exhalaisons corporelles, une température peu adaptée, trop chaud, pas de toilettes — l’envie pressante n’a qu’à se faire moins pressante — ; éreintant.
Fabrice Lardreau ne fait nullement le procès du RER, il semble même l’excuser d’être ainsi. N’a-t-il pas été abandonné, finalement ? Je suis moins compréhensif, et le côté saturé de la ligne B, les wagons bondés par la foule des heures de pointe, la promiscuité avec ces contemporains dont une (petite) poignée ne respecte rien, entre ceux qui mettent leurs pieds sur les sièges, leur musique à fond, qui racontent leur vie dans leur portable à tue-tête, s’imaginant peut-être être seuls dans leur salon, qui fument sur les quais, qui ne laissent pas passer ceux qui descendent, qui sautent par-dessus les barrières, qui… J’ai parfois l’impression de ne voir que cela, ces incivilités, cet irrespect lancinant, cette minuscule fraction qui occulte le reste. Et ça me met de mauvaise humeur et m’épuise. Il faudrait que j’adopte un autre état d’esprit, compréhensif, que je laisse couler, que je pense à autre chose, que je regarde ailleurs, bref, que je m’en foute. Mais non. Le RER, pour moi, c’est aussi le manque de liberté. L’antonyme de liberté. On sait quand on part quand la porte du wagon se referme, pas avant, entre les trains supprimés, les trains en retard, et j’en passe ; on ne sait pas quand on arrive. Les messages d’excuses diffusés dans les hauts-parleurs sont des pièces d’anthologies qui inspirent divers artistes au point que les retards des divers transports parisiens alimentent également la longue liste des excuses des étudiants eux aussi en retard ; on finit par abandonner l’idée même de leur demander de justifier le-dit retard.
Le RER peut devenir une routine enivrante ou aliénante, c’est selon, il peut aussi être une pose lecture salutaire — une parenthèse avec du temps à disposition — dans une journée de labeur par ailleurs marathon, ou bien un moment où les secondes qui défilent transmettent toute la pesante inertie du convoi. Parfois un événement sort la routine de l’ordinaire. Comme la fois où je lisais le bouquin d’un alpiniste, une jeune femme assise en face de moi me dit que l’auteur est son oncle, malheureusement, je descendais peu après, coupant court à une conversation pourtant prometteuse ; la fois où j’ai perdu la lanière de mon sac dans les mâchoires d’une porte, imaginant déjà que j’allais devoir y passer la nuit ou abandonner mon sac à son triste sort ; le reste des expériences singulières n’est pas particulièrement digne d’intérêt, à part quelque one-man show inopiné, de temps en temps, quelques disputes entre passagers éreintés et les nerfs à vifs, ou des sessions « musicales » imposées par des joueurs de guitare ou d’accordéon sur fond musical grésillant, pour une p’tite pièce au fond du chapeau, plus souvent. Pas de quoi garder en mémoire. Généralement les gens sont serrés les uns à côté des autres dans une large indifférence, les écouteurs vrillés sur les oreilles pour s’isoler dans un monde peut-être meilleur. Musicalement, cela s’entend.